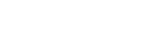Développement de jumeaux numériques pour étudier la mécanobiologie squelettique
J-12
Doctorat Doctorat complet
Sciences pour l'Ingénieur
Ile-de-France
- Disciplines
- Autre (Sciences pour l'Ingénieur)
- Laboratoire
- MODÉLISATION ET SIMULATION MULTI ECHELLE
- Institution d'accueil
- Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Ecole Doctorale de l'Institut Polytechnique de Paris
- Ecole doctorale
- Sciences, ingénierie et environnement (SIE) - ED 531
Description
Lostéoporose, marquée par une perte de masse osseuse liée à lâge et un risque accru de fractures, est un problème majeur de santé publique. Les traitements médicamenteux et l'exercice physique sont évalués selon leur capacité à réduire ce risque. Pour étudier la maladie et tester les traitements, la recherche sappuie sur des modèles animaux. Le modèle de souris est le plus utilisé grâce à sa petite taille, sa génétique bien connue et sa facilité de manipulation. Il a permis des avancées importantes sur le remodelage osseux et la réponse mécanique. Toutefois, labsence de canaux de Havers dans los cortical des souris limite la transposition des résultats aux humains, chez qui ces structures sont essentielles au remodelage.Le lapin, en revanche, possède une architecture osseuse plus proche de celle de lhumain, incluant les canaux de Havers. Sa taille permet aussi des essais biomécaniques plus représentatifs. Lévolution de lostéoporose chez le lapin (augmentation de la porosité corticale, amincissement trabéculaire, altération du remodelage) reflète mieux celle de lhumain. Ses réponses aux traitements pharmacologiques et au chargement mécanique sont également plus proches de celles observées chez lhomme.
Néanmoins, même les modèles les plus avancés ne permettent pas encore de prédire avec précision le risque de fracture ou la progression de la maladie chez lhumain. La densité osseuse ou la porosité ne suffisent pas à elles seules : la résistance osseuse dépend aussi de la microstructure, des propriétés matérielles et des conditions de charge. Par ailleurs, on ignore encore dans quelle mesure les réponses mécanobiologiques animales reflètent réellement les adaptations humaines.
La thèse propose de développer des jumeaux numériques de modèles animaux (souris et lapin) pour explorer les effets combinés du chargement physiologique et des traitements sur ladaptation osseuse. Ces modèles intègreront simulations biomécaniques et données expérimentales, pour mieux comprendre les sollicitations typiques de chaque espèce (marche, saut, etc.). Ils tiendront compte des propriétés matérielles et de la microstructure osseuse, influencées par la mécanique, létat de santé et les traitements.
En simulant ces charges et en les comparant aux seuils expérimentaux de rupture, des facteurs de sécurité seront établis. Ils indiqueront à quel point los fonctionne près de ses limites de résistance dans des conditions normales. Lobjectif final est de construire un cadre comparatif entre espèces, intégrant conditions de chargement, adaptation osseuse et réponse aux thérapies. Ce cadre aidera à mieux choisir les modèles animaux les plus pertinents pour la recherche mécanobiologique, en identifiant ceux qui reproduisent au mieux les caractéristiques humaines, tant du point de vue mécanique que pathologique.
À terme, cette approche vise à combler le fossé entre les modèles animaux et la clinique humaine, pour permettre une meilleure transposition des résultats précliniques aux stratégies thérapeutiques destinées à préserver la santé osseuse.
Compétences requises
Le(la) candidat(e) devra posséder une formation solide en biomécanique, sciences de lingénieur et modélisation numérique. Des compétences en programmation (ex. : Python, Matlab, ou logiciels de simulation par éléments finis) sont souhaitées. Une appétence pour les approches interdisciplinaires à linterface entre mécanique, biologie et santé sera un atout. Un bon niveau danglais est requis pour lenvironnement international du projet.Bibliographie
[1] J. Compston et al., Osteoporosis, The Lancet, 393(10169), 2019, pp364 376.[2] P. Pivonka et al., Advances in mechanobiological pharmacokinetic-pharmacodynamic models of osteoporosis treatment Pathways to optimise and exploit existing therapies, Bone, 186, 2024, 117140.
[3] M. Stein et al., Why Animal Experiments Are Still Indispensable in Bone Research: A Statement by the European Calcified Tissue Society, Journal of Bone and Mineral Research, 38(8), 2023, pp10451061.
[4] F. Elefteriou and X. Yang, Genetic mouse models for bone studiesStrengths and limitations, Bone, 49(6), 2011, pp12421254.
[5] I.S. Maggiano et al., Three-dimensional reconstruction of Haversian systems in human cortical bone using synchrotron radiation-based micro-CT: morphology and quantification of branching and transverse connections across age, J. Anatomy, 228(5), 2016, pp719-732.
[6] N. Koh et al., Preclinical rodent models for human bone disease: including a focus on cortical bone, Endocrine Reviews, 45, 2024, pp493520.
[7] K. D. Harrison et al., Cortical Bone Porosity in Rabbit Models of Osteoporosis, Journal of Bone and Mineral Research, 35(11), 2020, pp2211-2228.
[8] A.P. Baumann et al., Development of an in vivo rabbit ulnar loading model, Bone, 75, 2015, pp55-61.
[9] L.M. Wanket, Animal Models for Evaluation of Bone Implants and Devices: Comparative Bone Structure and Common Model Uses, Veterinary Pathology, 52(5), 2015, pp842-850.
Mots clés
Biomécanique osseuse, Jumeaux numériques, Modèles animaux, Risque de fractureOffre financée
- Type de financement
- Contrat Doctoral
Dates
Date limite de candidature 31/07/25
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/25
Date de création17/06/25
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisAucun
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
Vous devez vous connecter pour voir ces informations.
Cliquez ici pour vous connecter ou vous inscrire (c'est gratuit !)